L'identification - Genèse d'un travail d'Etat
Collectif
Présentation
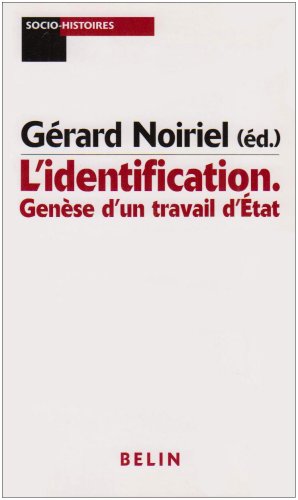 Comme l'affirme d'entrée Gérard Noiriel, le nombre de recherches consacrées au processus d''identification des personnes s'est considérablement multiplié au cours de la dernière décennie. C'est sans doute que cette opération constitue d'une certaine manière l'essence même du travail des sciences sociales, pris en tension entre la reconnaissance de la singularité de chaque individu (indentification) et la possibilité de le relier à une ou plusieurs catégories d'appartenance (classification). Et pris aussi entre une recherche d'objectivation et les risques importants d'arbitraire que revêt immanquablement une entreprise de ce type. L'arbitraire est précisément à l'oeuvre lorsque ce travail d''identification est opéré par l'Etat, dans ses diverses composantes, et c'est autour de cette question que gravitent les différents travaux réunis dans le présent ouvrage.
Comme l'affirme d'entrée Gérard Noiriel, le nombre de recherches consacrées au processus d''identification des personnes s'est considérablement multiplié au cours de la dernière décennie. C'est sans doute que cette opération constitue d'une certaine manière l'essence même du travail des sciences sociales, pris en tension entre la reconnaissance de la singularité de chaque individu (indentification) et la possibilité de le relier à une ou plusieurs catégories d'appartenance (classification). Et pris aussi entre une recherche d'objectivation et les risques importants d'arbitraire que revêt immanquablement une entreprise de ce type. L'arbitraire est précisément à l'oeuvre lorsque ce travail d''identification est opéré par l'Etat, dans ses diverses composantes, et c'est autour de cette question que gravitent les différents travaux réunis dans le présent ouvrage.
Dans son introduction, Gérard Noiriel pose logiquement le cadre général, expliquant tout d'abord que l'identification représente un nouveau paradigme en sciences sociales, succédant à celui de l'identité, tel qu'il a pu être développé notamment par l'analyse structuraliste. Après avoir rappelé l'apport décisif de la philosophie en la matière, via notamment les travaux de Charles Peirce et ceux de Paul Ricoeur, l'auteur du Creuset français [1] s'appuie ensuite sur les apports de Jack Goody et de Norbert Elias pour expliquer en quoi le passage de la communication orale à l'écrite comme fondement de la culture, ainsi que l'allongement des chaînes d'interdépendance mis en évidence respectivement par l'anthropologue et le socio-historien, ont constitué les facteurs décisifs pour expliquer le développement du souci étatique d'identifier les individus circulant sur son territoire. Après avoir présenté les différentes contributions de ce livre, il termine la sienne en évoquant le problème mis en évidence notamment par Didier Bigo et Pierre Piazza. A savoir que le développement de techniques identititaires, tel que nous l'expérimentons actuellement avec intensité, n'est pas sans entraîner une stigmatisation des migrants pauvres, et surtout sans comporter le risque d'être récupérées ultérieurement par des régimes autoritaires, voire totalitaires. C'est pourtant ce que l'histoire du siècle écoulé aurait pu (du ?) nous enseigner...
Le travail étatique d'identification ne date pas des dernières décennies. C'est ce que Claudia Moatti vient nous rappeler en s'intéressant à cette question dans...la Rome antique. Elle montre tout d'abord que deux logiques sont à prendre en compte pour comprendre l'essor des pratiques d'identification : l'une administrative -et particulièrement fiscale-, et l'autre tenant à la reconnaissance sociale. C'est cette dernière qui confère à des signes comme le vêtement une importance cruciale, particulièrement dans les strates « supérieures » de la société romaine. C'est en particulier la mobilité croissante des individus avec l'anonymisation qu'elle entraîne qui expliquent le développement du besoin d'identifier la population. Ainsi, tandis que sous la République, le census ne concerne que les seuls citoyens, celui-ci, après avoir été étendu à tous les sujets de l'Empire, disparaît cependant à la fin du Ier siècle pour laisser la place à des recensements locaux, organisés généralement à l'échelle provinciale. Celui-ci « devient la marque de la domination romaine et, localement, du contrôle social de la population ». Il inaugure également une systématicité de l'enregistrement écrit de la population et des biens, avec une finalité fiscale à ne pas négliger. Qui dit papier dit falsification, et c'est le développement de cette pratique que Claudia Moatti développe dans la dernière partie de son article.
Petit bond dans le temps ensuite avec Claire Judde de Larivière qui retrace le développement au Moyen-Age de modes d'identification après une période où dominaient l'interconnaissance et la communication orale. Elle montre ainsi comment, aux XIème et XIIème siècle se sont développés parallèlement de nouveaux modes de désignation sociales (le statut et le nom patronymique) et les marqueurs matériels d'identité tels que les sceaux, armoiries, vêtements et insignes. L'Eglise joue alors un rôle déterminant dans l'enregistrement des identités à partir du XIIIème siècle (du fait de l'obligation annuelle de se confesser instaurée par le concile de Latran IV !), avant de passer en quelque sorte le relais aux autorités des Etats naissants. Fait notable : la consignation des identités précède la question de leur contrôle. Mais la diffusion des « papiers d'identité », et plus particulièrement du passeport au XVIème siècle ne s'accompagne pas d'un recours massif à la fraude. Car comme le note l'auteure, « la fraude n'est pas fonction des possibilités techniques [...], mais bien un phénomène marginal et rare ».
L'essor des papiers d'identité est donc indissociable de celui de la mobilité, ce que la contribution de Vincent Denis vient confirmer. Celui-ci revient en effet sur l'importance que revêt la « nébuleuse » de leurs papiers pour les pauvres au XVIIIème siècle. Faisant ainsi écho aux travaux de Robert Castel [2], Vincent Denis rappelle en effet l'importance de la répression policière vis-à-vis du vagabondage et de la mendicité. Les papiers remplissent en effet, selon leur nature, deux fonctions principales : marquer l'appartenance à une communauté (« l'affiliation » pour reprendre le vocabulaire de Robert Castel), et l'autorisation de circuler. C'est cependant cette répression qui va être à l'origine du développement des fraudes, que l'auteur date des années 1770, soit le crépuscule de l'Ancien Régime, dans la mesure où elle suscite une véritable « panique vis-à-vis des « papiers », dont il faut se munir à toute force, sans forcément comprendre leur fonctionnement ». Le lecteur sera ici tenté d'établir une « concordance des temps » -pour reprendre le titre d'une émission radio- entre cette époque et la période actuelle, pour peu qu'il fréquente certains « héritiers » des vagabonds d'alors...
Changement de décor (ou plus exactement de « côté »), avec Peter Becker, qui retrace la -difficile- intégration des innovations criminologiques par les polices allemandes et autrichiennes au XIXème siècle. Il montre ainsi que, malgré le rôle moteur des gazettes policières, des ministères de l'Intérieur et de certains chefs de police enthousiastes vis-à-vis des « découvertes » de Bertillon, les acteurs locaux, à commencer par les conseils municipaux, ont montré de fortes réticences à adopter les mesures anthropométriques, du fait notamment des investissements humains et matériels qu'elles semblaient nécessiter. Peter Becker préconise ainsi de porter une attention plus soutenue aux négociations qui conditionnent la réussite ou l'échec d'innovations en matière administrative, nous encourageant de ce fait à nous prémunir contre une vision souvent trop moniste de l'appareil d'Etat.
Dans un article particulièrement édifiant, Ilsen About retrace pour sa part l'essor de la gestion policière de l'immigration en France, qui s'est essentiellement déroulé durant l'entre-deux-guerre. C'est en effet à partir de 1917 que les étrangers installés dans l'Hexagone sont tenus de détenir une carte d'identité, une décision du ministre de l'Intérieur qui entraînera corrélativement la généralisation d'une pratique devenue aujourd'hui (tristement) banale : les contrôles d'identité. Ilsen About retrace ainsi les multiples modifications de la réglementation en la matière : dans la durée et les conditions de délivrance -notamment le montant de la taxe à acquitter pour sa délivrance- du document, les différentes couleurs que pouvaient revêtir le document, matérialisation de la hiérarchie qui s'établissait - déjà- aux yeux des autorités selon l'origine géographique et le secteur d'activité du porteur. Car, bien avant que certains gouvernants ne se mettent à plaider ouvertement pour une « immigration choisie », les conséquences économiques de l'immigration résidaient déjà au coeur des préoccupations des responsables politiques. En témoignent ainsi certains passages très explicites (dans leur cynisme...) de circulaires rapportés par l'auteure, et surtout les multiples restrictions instaurées pour « protéger le marché du travail national », en restreignant rigoureusement la possibilité pour les étrangers d'accéder à certains secteurs économiques, ou de passer d'une profession à une autre. Ilsen About décrit ensuite le renforcement progressif de la police des étrangers, passant notamment par la centralisation des données les concernant (dont, déjà, des données biométriques tels que les relevés d'empreintes que les douanes américaines ont su remettre au goût du jour...). Au final, son travail montre bien comment la bureaucratisation des procédures n'entraîne pas nécessairement une rationalisation du contrôle, mais peut favoriser comme ici le développement d'une domination administrative laissant la part belle à l'arbitraire.
Nouvelle confirmation de la « gène » que constitue la mobilité pour les autorités étatiques, l'article d'Henriette Asséo est lui consacré à « l'invention des « Nomades » » en Europe au cours du XXème siècle. Cet intitulé énigmatique renvoie en fait au constat que la persécution des Tsiganes comme « mauvais pauvres » sur le Vieux continent est en fait très récente. Celle-ci s'est mise en place à partir au début du XXème siècle. Auparavant, ceux-ci ont en effet largement bénéficié des patronages seigneuriaux, avant d'être « simplement » refoulés occasionnellement. C'est bien le passage d' « un dispositif de contrôle a minima d'ambulants méprisables à une fièvre obsidionale qui conçoit les « Nomades » comme une figure emblématique d'un complot de subversion sociale des basses classes transformé en entreprise de subversion étrangère » qu'Henriette Asséo s'applique ici à retracer en tant que processus, non sans mentionner le sommet de cette persécution avec la volonté nazie d'exterminer ces populations nomades.
Nicolas Mariot et Claire Zalc s'intéressent également à l'identification telle qu'elle fut mise en oeuvre par le régime nazi et ses collaborateurs, mais en prenant pour « objet » les résidents juifs de la ville de Lens, sous-préfecture du Pas-de-Calais, durant la Seconde Guerre Mondiale. Au cours d' une enquête digne d'un bon polar, les deux chercheurs montrent que la déclaration constituait une étape nécessaire à l'identification des Juifs comme tels par les autorités, mais que beaucoup parmi les personnes concernées s'y sont finalement soumis. Comme si elles avaient intégré le fait que le fait de ne pas se dire juif ne pouvait en rien les prémunir contre la stigmatisation et les déportations.
La nationalité française, par opposition aux autres, semble en revanche avoir constitué une certaine protection contre la déportation. A noter enfin l'intérêt méthodologique de l'article, qui, par ses résultats, plaide pour la quantification des données contre une approche psychologisante des actions individuelles. Qu'il s'agisse de la déclaration de sa confession ou de la décision de rester ou partir face à l'envahisseur allemand, les deux auteurs prouvent en effet ici que le couple « naïveté-lucidité » permet bien mieux de rendre compte des comportements des uns et des autres que l'alternative entre « consentement » ou « résistance ».
Dans sa contribution, Nathalie Moine revient enfin sur un phénomène trop mal connu : les « frontières intérieures » en Union Soviétique. Comme dans la République Populaire de Chine actuelle, un certain nombre de citoyens soviétiques détenaient en effet un passeport intérieur restreignant leurs possibilités résidentielles. Tous n'étaient cependant pas soumis au même régime, puisqu'il existait des zones dont tous les résidents devaient porter un passeport, d'autres où seuls les candidats à la mobilité y étaient contraints, et enfin certaines zones interdites à la résidence pour certaines catégories de la population. Il faut cependant en la matière tordre le cou à un mythe tenace, explique l'auteure : l'idée selon laquelle ce système aurait servi à l'établissement d'une frontière étanche entre ville et campagne. Elle montre qu'en fait, le passeport représentait à la fois un privilège pour ses porteurs, mais aussi un instrument de la lutte des classes servant à surveiller et purger les « ennemis de la Révolution ». Instauré par Staline, ce système survivra cependant largement à son auteur, puisqu'il faudra attendre la fin des années 1970 pour que l'ensemble de la population soviétique soit doté d'un passeport. Le passeport intérieur représente ainsi pour Nathalie Moine « un des héritages les plus significatifs du passé russe et soviétique ». C'est que cet instrument apporte un reflet matériel de la hiérarchisation territoriale de la société russe. Une particularité elle-même héritée de l'histoire tsariste puis de la Révolution bolchévique, dans lesquelles certaines nationalités ont pu être perçues tour à tour comme des traîtres à la patrie.
Par Igor Martinache pour Liens Socio.
Notes
[1] Seuil, 1992. Un ouvrage incontournable sur l'histoire de l'immigration en France aux 19e et 20e siècles.
[2] Voir Les métamorphoses de la question sociale, Fayard, 1995


