Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l'action collective
Présentation
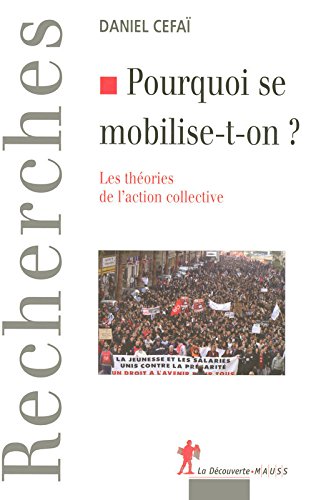 L'ouvrage de Daniel Cefaï propose d'examiner les différentes manières d'aborder la question des actions collectives en sciences sociales, en dressant un état des savoirs sur cette question, couvrant toute la littérature sur le sujet depuis près de cent vingt ans. L'auteur souhaite apporter un nouveau regard sur bon nombre d'études dont certaines ont été « mises au placard » ou jugées caduques. Et c'est bien en cela que réside l'originalité de l'ouvrage. Il nous propose certes un panorama complet et détaillé des travaux « classiques » présentant de ce fait les outils d'analyse dans leur contexte historique et politique, tout en examinant l'apport de certains auteurs dont les travaux ont souvent été, selon lui, rejetés trop rapidement ou utilisés seulement superficiellement. C'est ainsi, selon lui, le cas de la théorie du collective behavior élaborée par l'Ecole de Chicago ou de la frame analysis théorisée par Goffman.
L'ouvrage de Daniel Cefaï propose d'examiner les différentes manières d'aborder la question des actions collectives en sciences sociales, en dressant un état des savoirs sur cette question, couvrant toute la littérature sur le sujet depuis près de cent vingt ans. L'auteur souhaite apporter un nouveau regard sur bon nombre d'études dont certaines ont été « mises au placard » ou jugées caduques. Et c'est bien en cela que réside l'originalité de l'ouvrage. Il nous propose certes un panorama complet et détaillé des travaux « classiques » présentant de ce fait les outils d'analyse dans leur contexte historique et politique, tout en examinant l'apport de certains auteurs dont les travaux ont souvent été, selon lui, rejetés trop rapidement ou utilisés seulement superficiellement. C'est ainsi, selon lui, le cas de la théorie du collective behavior élaborée par l'Ecole de Chicago ou de la frame analysis théorisée par Goffman.
Avant d'exposer l'objectif de son ouvrage, Daniel Cefaï définit la notion d'action collective. Pour lui, l'action collective est « une action concertée » qui « implique une intention consciente » ; elle existe dans un contexte temporel et spatial, elle est ordonnée en forme organisationnelle et présente des visées multiples au sein desquelles le droit joue un rôle fondamental.
Invitant à faire tomber les barrières des disciplines, il donne à son ouvrage quatre objectifs : exposer la sociologie du comportement collectif ; dresser un panorama de l'action collective et des mouvements sociaux ; relire la littérature scientifique relatives aux nouveaux mouvements sociaux ; explorer l'œuvre de Goffman en faveur d'une microsociologie de l'action collective. Devant l'ampleur des recherches et de l'argumentation fort longue et documentée de Daniel Cefaï, il nous faut nous résoudre à présenter l'ouvrage dans son ensemble en soulignant quelques un de ses passages centraux.
La première partie de Pourquoi se mobilise-t-on ? a pour objectif explicite de « réhabiliter l'héritage de l'école de Chicago ». Pour ce faire, l'auteur part des tous premiers travaux dressant ainsi une historiographie de la notion de foule à celle de masse. La notion de mouvement social s'est imposé comme catégorie d'analyse en rupture avec la théorie du comportement collectif et de l'opinion publique telle qu'elle est développée par l'Ecole de Chicago. S'appuyant notamment sur les travaux de Park qui étudie les logiques des interactions individuelles, intégrant à ces outils des modèles explicatifs empruntés à la psychologie et à la psychanalyse, l'auteur appelle à ne pas oublier les apports de l'Ecole de Chicago tels que la dimension affective et culturelle des engagements collectifs. L'auteur revient ensuite sur les études de psychologie collective élaborée à partir des études sur la Révolution Française et la Commune de Paris. Il aborde ici des auteurs comme Taine, Laschi, Van Ginneken... La théorie des actions irrationnelles telle que la défendait Le Bon soulignait le caractère primitif des foules, leur adoration des idoles et leur incapacité à raisonner et à juger. Il montre comment les chercheurs en sont venus à remplacer la notion de foule par celle de masse, notant les images que cette notion implique : la masse est « une vaste agrégation d'individus isolés et anonymes », elle est un corps « mou et opaque » et « un rouage dans un processus organisationnel » (Lederer, Ortega y Gasset, Arendt) (pp.60-61). L'auteur poursuit son argumentation en indiquant les types de paradigmes qui se sont succédés dans l'analyse des mouvements sociaux, soulignant la disparition de certains domaines d'analyse due à l'épuisement de certains de ces paradigmes, en particulier l'analyse des rumeurs et des émeutes. L'auteur achève cette partie en rappelant un des apports essentiels de l'Ecole de Chicago : la comparaison de la scène publique à un dispositif théâtral où grâce à l'identification à des personnages publics, un acteur peut symboliquement jouer un rôle dans le drame social et ainsi se positionner par rapport aux autres acteurs.
La seconde partie étudie « la procession des modèles d'action collective qui s'est déroulée depuis 1960 ». Au cours des années 1960, on assiste à l'abandon presque total de la problématique des comportements collectifs, abandon notamment du à l'émergence de nouvelles formes d'action collective : des mouvements menés par les minorités qui revendiquent l'égalité, s'appuyant sur le droit (le mouvement pour les droits civiques, le mouvement étudiant, etc.). Devant ces actions concertées et organisées par les minorités pour contrecarrer leur aliénation, les théories de l'irrationalité tombent en désuétude faisant jour aux théories de l'action rationnelle (Olson) et aux théories de la mobilisation des ressources. L'auteur rappelle les limites de ces approches, qui selon lui constituent des boîtes à outils de description et d'analyse des perspectives sur le social, sur la culture et sur l'action. Au cours de cette deuxième partie, l'auteur tente de « regagner de la réflexivité perdue par rapport aux modélisations contemporaines de l'expérience et de l'action collective » (p.209). Pour cela, il repère les points aveugles et les moments forts et tente de recadrer ses schèmes d'analyse par rapport à leur lien avec l'expérience démocratique. Avec la contextualisation (économique, politique, etc.) des actions collectives, les chercheurs commencent à s'intéresser à la sociologie culturelle. L'action rationnelle doit désormais s'envisager avec d'autres logiques comme celle de solidarité, de légitimité, de liberté, etc. Ces théorisations mettent fin à l'ère des foules et de la masse et signe l'avènement, après le soulèvement de mai 1968, des Nouveaux Mouvements Sociaux, objet de la troisième partie, et défendus en France, notamment par Touraine et Melucci. L'auteur insiste sur la nécessité de décloisonner les domaines de recherche et appelle à prendre en compte les visions du monde des acteurs, les interactions ainsi que les réseaux. Il conclut que les recherches prennent le chemin d'enquête sur la « culture » dans la mesure où elles tentent de problématiser la question de la signification et d'intégrer la notion de sens dans leur démarche analytique.
Selon Daniel Cefaï, les outils et les catégories d'analyse n'ont cessé de s'affiner et de s'enrichir. Ainsi, il considère l'apport des pionniers du structuralisme en déplorant l'éloignement de la question du sens et la décontextualisation spatiale et temporelle. Heureusement, dit-il, la sociologie culturelle a réintroduit au fur et à mesure ces notions au sein des travaux sur les actions collectives, et certains auteurs comme Tilly ou Mac Adam ont contribué à les imposer. Dans cette partie suivante où l'auteur examine une série de concept ayant trait à la « culture », il revient notamment sur l'analyse des cadres de Snow dont il estime qu'elle a apporté « un supplément d'âme aux perspectives structuralistes » (p. 408) en renouvelant les liens avec la psychologie sociale de l'Ecole de Chicago. Les études des nouveaux mouvements sociaux introduisent des réflexions sur le langage, l'imaginaire, les représentations et les symboliques : « il n'y a pas de conflit social' sans un champs culturel' qui soit partagé par tous les différents acteurs » (p. 418). La naissance dans les années 1980 de la sociologie culturelle va apporter beaucoup aux recherches sur les actions collectives et elle va conduire à l'émergence de nouvelles thématiques ; les récits d'acteurs et les récits de vie sont désormais au centre des enquêtes, les chercheurs empruntent des outils d'analyse du discours (rhétorique de Burke, dialogique de Bakhtine) et puisent chez Goffman et Edelman les outils sur la construction de sens.
La quatrième et dernière partie de cet ouvrage apporte un point de vue davantage personnel. Daniel Cefaï introduit ce travail de relecture de l'œuvre de Goffman par cette phrase : « L'œuvre de Goffman a été, selon moi, sous-évaluée dans l'étude des phénomènes civiques et politiques » (p.549). Ils pensent que certaines des enquêtes de Goffman peuvent nourrir les recherches sur les actions collectives et qu'il est nécessaire de réactiver la réflexion sur les opérations de cadrage et qu'il faut examiner la dramaturgie des rencontres et des rassemblements publics encore trop souvent méconnu des scientifiques français afin de l'appliquer à l'étude des meetings et des manifestations. Il souligne deux apports qui lui semblent être d'une importance majeure pour les recherches de ce domaine. Il s'agit d'une part de l'analyse des opérations de cadrage de l'expérience et de l'activité (Frame Analysis) qui encouragent à considérer les actions collectives d'un point de vue ethnographique avant même d'entreprendre leur analyse qui est, selon l'auteur, indissociable de l'analyse des situations où elles sont mises en œuvre. Le second apport présenté par l'auteur est théorisé dans Behavior in public space. Dans cet ouvrage, Goffman encourage à prendre en compte l'étude des microcontextes de l'action collective et propose une analytique des éléments constitutifs d'une situation et de ses « moments » (Goffman). Daniel Cefaï prône donc une approche ethnographique et microsociologique des actions collectives. Il dit à ce sujet : « Le micro n'est pas dans le macro comme le petit est dans le grand (...) En localisant le global et en redistribuant le local, en reconnectant les sites et en rassemblant le social, elle [la microanalyse] montre comment une action se fait et comment elle se fait collective » (p.701/702).
Au total, loin d'être une célébration de la naissance des nouveaux mouvements sociaux, cet ouvrage appelle à élargir la notion de politique contestataire. Il rappelle qu'il faut se méfier et ne pas parler des mouvements d'action collective comme d'une catégorie unitaire et homogène, il appelle à la prudence et souligne le dynamisme du secteur de recherche des actions collectives. Cependant, il estime que ce domaine de recherche gagnerait à être associée plus souvent aux problématiques en rapport avec la Démocratie et les politiques publiques. Les chercheurs devraient développer des enquêtes sur les « arènes publiques » (Gusfield) et que les analyse devraient questionner le lien entre les figures de la citoyenneté formelle et concrète. En effet, il pense que les actions collectives sont l'expression d'une nouvelle forme de participation démocratique et consistent en des batailles de « droit » pour le « bien public » et contre « le mal public ». Pour conclure, cet ouvrage massif (723 pages) permet une double lecture : à la fois ouvrage de référence, grâce à la compilation d'un large savoir encyclopédique, il saura intéresser tout étudiant s'interrogeant sur l'étude des mouvements sociaux ; et à la fois ouvrage d'analyse critique des paradigmes de l'action collective qui proposera aux chercheurs de porter un regard différent et de s'engager vers de nouveaux raisonnements.
Par Séverine Mayol, doctorante en sociologie à l'Université de Paris 5 (GEPECS) sous la direction de M. Spurk.


