Défendre la ville. La police, l'urbanisme et les habitants
Présentation
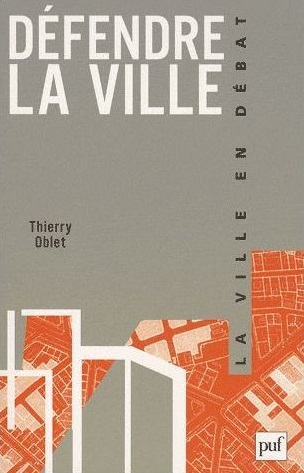 Le seul titre, Défendre la ville, pourrait laisser penser que nous sommes en présence d'un précis de stratégie militaire promis à un beau succès de librairie en ces temps troublés, mais il n'en est rien. Ce petit ouvrage de Thierry Oblet vient en fait inaugurer une nouvelle collection dirigée par Jacques Donzelot aux PUF et intitulée « La ville en débat ». Son auteur, maître de conférences à l'Université Victor Segalen - Bordeaux II et chercheur au Laboratoire d'analyse des problèmes sociaux et de l'action collective (LAPSAC) et au Centre d'études des politiques sociales (CEPS) [1], vient y apporter sa contribution au débat sur la police des villes, relancé récemment avec la réintroduction annoncée de la police de proximité, sous une autre appellation, par le Président de la République qui l'avait lui-même supprimée.
Le seul titre, Défendre la ville, pourrait laisser penser que nous sommes en présence d'un précis de stratégie militaire promis à un beau succès de librairie en ces temps troublés, mais il n'en est rien. Ce petit ouvrage de Thierry Oblet vient en fait inaugurer une nouvelle collection dirigée par Jacques Donzelot aux PUF et intitulée « La ville en débat ». Son auteur, maître de conférences à l'Université Victor Segalen - Bordeaux II et chercheur au Laboratoire d'analyse des problèmes sociaux et de l'action collective (LAPSAC) et au Centre d'études des politiques sociales (CEPS) [1], vient y apporter sa contribution au débat sur la police des villes, relancé récemment avec la réintroduction annoncée de la police de proximité, sous une autre appellation, par le Président de la République qui l'avait lui-même supprimée.
Ainsi, ce sont non seulement certains syndicats des forces de l'ordre, comme l'UNSA-Police, qui s'opposent à ce retour, mais le débat avait également atteint la communauté sociologique, certains chercheurs ayant pointé les limites du dispositif précédent [2] , tandis que d'autres ont souligné le rôle central des relations tendues entre policiers et jeunes des quartiers pauvres dans le déclenchement des violences urbaines [3].
Quoiqu'il en soit, si la question de l'insécurité charrie un certain nombre d'idées fausses savamment entretenues par certains entrepreneurs de morale (...et de solutions sécuritaires) [4], elle n'en est pas pour autant une simple chimère. Il s'agit surtout, pour comprendre ce phénomène, de distinguer à la suite de Franck Furstenberg la peur personnelle du crime (« crime risk ») et la préoccupation morale et politique pour le crime (« crime concern »). On constate alors que l'insécurité varie amplement d'un quartier à l'autre d'une même ville dans ses formes et son intensité, d'où la nécessité de diagnostics locaux précis.
Il serait ainsi faux de croire que le débat sur la sécurité urbaine se construirait autour d'un clivage entre partisans de la « prévention situationnelle », pour qui sécuriser l'espace public passe par le développement des « murs » et des techniques de surveillance, notamment vidéo, et défendeurs de la « prévention sociale » pour qui il s'agit moins d'agir sur le crime que sur les causes du crime [5]. Face au développement actuel de l'offre de sécurité privée [6] -dont la relation avec le « monopole de l'exercice la violence légitime » qui caractérise l'Etat selon Max Weber est sans doute plus ambiguë qu'il n'y paraît-, Thierry Oblet prône un renforcement de la « compétence politique » des maires, permettant à ces derniers de mobiliser le « capital social » de leur communauté, qui reste encore le meilleur rempart contre une « incivilité » excessive. Une proposition décidément d'actualité en ces lendemains d'élections municipales...
Pour en arriver à cette conclusion, Thierry Oblet commence par retracer la genèse de la problématique de l'insécurité urbaine dans la tradition sociologique. S'appuyant notamment sur les analyses des sociologues de l'Ecole de Chicago, il rappelle ainsi que l'insécurité est rapidement perçue comme l'envers de la liberté et de la mobilité qu'offre l'anonymat de la société urbaine par comparaison avec les communautés rurales, pour reprendre la distinction établie par Ferdinand Tönnies. Puis, ce phénomène perd sa « normalité » sociologique [7], et les sociologues de la seconde moitié du XXème siècle en font alors le symptôme principal de la « crise » urbaine. Cette représentation scientifique fluctuante a en quelque sorte accompagné les transformations de la prise en charge publique de cette question. Si le Royaume-Uni a dès le début du XVIIIème siècle instauré l'occupation policière des espaces publiques pour pallier l'affaiblissement de l'interconnaissance en contexte urbain, de telles politiques n'ont été développées en France que sous la IIIème République, et encore ont-elles été confiées à des agents municipaux. Mais à partir de la moitié du XXème siècle, l'étatisation des polices municipales a distendu progressivement le lien entre policiers et populations locales, faisant de la surveillance du territoire une mission accessoire et dévalorisée face au prestige des « belles » enquêtes judiciaires, une tendance encore renforcée par le progrès technique signant par exemple la disparition des rondes pédestres.
Une rupture s'opère cependant en 1983 avec la création du Conseil national de prévention de la délinquance à la suite du rapport de la commission des maires sur la sécurité, qui promeut la coopération entre acteurs de la prévention et ceux de la répression. Mais le bilan qui en est dressé dix ans plus tard est plus que mitigé, un tiers des 750 CCPD (conseils communaux de prévention de la délinquance) ainsi créés n'ayant d'existence que sur le papier, tandis que les autres ont dérivé de l'objectif initial vers un traitement plus global des problèmes sociaux. Les Contrats locaux de sécurité (CLS) lancés en 1997 visaient en partie à corriger ces écueils, mais de nouveau, à l'usage, ils sont moins apparus comme une adaptation au contexte local qu'à la déclinaison à cette échelle de normes définies au niveau central de l'Etat. Ce sont finalement le lancement de la police de proximité et des maisons de justice et du droit (MDJ) dans les années 1990 qui ont réellement incarné le rapprochement avec la population locale.
Face à ces errements politiques s'est développée une « normalisation sécuritaire de l'urbanisme », dans la lignée de la généralisation de l'éclairage public aux XVIIème et XVIIIème siècles, avec l'essor des digicodes, interphones, badges, caméras de vidéosurveillance et autres dispositifs composant la « prévention situationnelle », et parmi lesquels il ne faut pas omettre la « résidentialisation » mise en œuvre par les bailleurs HLM et visant à « casser » les grands halls en plus petites entrées pour favoriser la surveillance par interconnaissance des résidents. De telles mesures sont cependant accusées, non sans fondements, de ne faire que déplacer les problèmes plutôt que d'en traiter les racines.
Jusque-là rédigé sur un ton plutôt neutre, l'essai de Thierry Oblet devient plus polémique dans le troisième chapitre. Il critique ainsi la thèse défendue notamment par Loïc Wacquant de la substitution actuelle de l'Etat pénal à l'Etat social [8], c'est-à-dire d'un traitement punitif et carcéral de la question sociale. Thierry Oblet ne conteste cependant pas le tournant répressif qui accompagne l'affaiblissement des politiques sociales, et qu'étaye un certain nombre d'indicateurs éloquents [9], mais critique davantage le caractère qu'il juge « caricatural » de la thèse défendue notamment par Loïc Wacquant.
Il s'agit ainsi selon lui de dissocier plus nettement la question urbaine de la question sociale, notant au passage que l'Etat social n'a pas encore rendu l'âme. Il examine donc les stratégies développées récemment outre-Atlantique - et diffusées depuis aux autres pays industrialisés- pour rétablir l' « ordre public » dans l'espace urbain sous les labels de « new prudentialism », qui renouvelle l'approche de la prévention en se focalisant sur sa dimension « situationnelle », la « new penology », qui consiste à durcir les peines dans le but essentiellement de rassurer les « honnêtes citoyens », et le « new urbanism », qui s'inscrit en rupture du fonctionnalisme et qui accorde une grande importance aux questions de sécurité.
Mais si la « théorie de la vitre cassée » qui consiste à réparer aussitôt les conséquences des incivilités pour en contenir l'expansion semble avoir effectivement rencontré une certaine audience auprès des organismes de logements sociaux notamment, des recherches récentes ont aussi mis en évidence en France l'existence d'un « travail de civilité » dans les espaces publics et commerciaux, ainsi que la participation spontanée de certains habitants à la « coproduction » de la sécurité. Et c'est dans cette participation « mêlée » entre habitants et pouvoirs publics que réside selon Thierry Oblet, qui s'appuie sur plusieurs travaux comme ceux de Jane Jacobs [10], la clé permettant de concilier liberté et sécurité dans l'espace urbain.
Celle-ci permet en effet d'accroître le « capital social » dans les quartiers, à la fois dans sa dimension collective que représente l'interconnaissance des occupants de l'espace, et dans son acception individuelle, qui permettrait aux habitants des quartiers pauvres d'acquérir ces « liens faibles » qui leur font souvent défaut et dont Mark Granovetter a bien montré la « force », décisive notamment dans la recherche d'emploi. Une telle participation « mêlée » devrait ainsi se substituer à la coopération de fait entre public et privé qui s'incarne de fait aujourd'hui dans le développement de la sécurité privée, même si celui-ci s'accompagne d'un contrôle croissant des pouvoirs publics à son égard. Il s'agit ainsi de rechercher des solutions dans le vécu quotidien des habitants plutôt que de s'en remettre aux préconisations des experts, et dans cette perspective, le maire a un rôle majeur à jouer dans l'animation de cette large « coproduction de la sécurité » et dans la « réunion des fragments de la ville ». S'il ne détaille guère ici les détails concrets de la mise en œuvre d'une telle politique, Thierry Oblet a cependant le mérite par cet essai court et accessible de relancer un débat crucial trop souvent obscurci par des oppositions dogmatiques et les manœuvres d'instrumentalisation politique qui y sont liées.
Igor Martinache pour Liens Socio.
Notes :
[1] Et auteur notamment de Gouverner la ville, PUF, "Le lien social", 2005
[2] Cf Sebastian Roché, Police de proximité, Nos politiques de sécurité, Paris, Seuil, 2005
[3] Cf Fabien Jobard, « Sociologie politique de la racaille. Les formes de passage au politique des "jeunes bien connus des services de police", in Hugues Lagrange et Marco Oberti (dir.), Émeutes urbaines et protestations. Une singularité française, Presses de Sciences-Po, 2006, p.59-79, ou Laurent Mucchielli, « Il faut changer la façon de « faire la police » dans les « quartiers sensibles » » dans l'ouvrage collectif Banlieue, lendemains de révolte, La Dispute, 2006, p.93-105
[4] Cf Laurent Mucchielli, Violences et insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat français, La Découverte, 2002
[5] Détournement de la formule de Tony Blair, l'ex-premier ministre britannique entendant être « dur avec le crime et avec les causes du crime »
[6] Voir par exemple la dénonciation qu'en fait le philosophe Martin Mongin, « Alarmante banalisation des vigiles », Le Monde diplomatique, janvier 2008
[7] Rappelons que pour Durkheim, le crime est un phénomène statistiquement normal dans le fonctionnement d'une société, c'est son absence totale qui serait inquiétante, signe que nous serions par exemple dans un régime totalitaire.
Il peut même s'avérer socialement utile quand il préfigure l'évolution des normes
[8] Voir par exemple le numéro intitulé « De l'État social à l'État pénal » des Actes de la recherche en sciences sociales, n°124, septembre 1998 qu'il a coordonné
[9] Voir par exemple « Un Américain sur cent derrière les barreaux », Adam Liptak, The New-York Times reproduit dans Courrier International, 6 mars 2008
[10] Déclin et survie des grandes villes américaines, Belgique, Mardaga, 1991 [1961]


