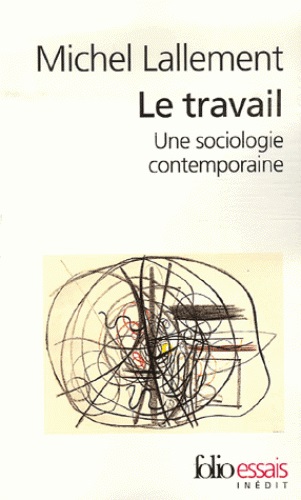Le travail, une sociologie contemporaine
Stephanie Fraisse-D'Olimpio
Présentation
Michel Lallement se fixe dans cet ouvrage un objectif ambitieux pour tenter d'analyser ce qui a été qualifié de « crise du travail » et cherche dans le champ de la sociologie du travail des réponses à la question centrale : « le travail fait-il société ? » et le cas échéant, « comment ? ». Les recherches et analyses produites par les sociologues spécialistes du travail ont finalement été peu mobilisées dans le débat social. Pourtant, elles offrent des outils d'interprétation objectifs des rapports collectifs et individuels au travail vécus le plus souvent sur un mode subjectif.
La thèse centrale de l'auteur est que dans ce contexte de mutations, le travail, constitue à la fois le moteur et le révélateur des changements et préserve plus que jamais son rôle central d'institution sociale. Michel Lallement étaye cette position en dégageant quatre composantes du travail-institution qui vont donner une ligne directrice à l'analyse de la littérature foisonnante en sociologie du travail. Les principes de di-visions, d'individuation, d'intégration et de régulation largement inspirés de l'analyse durkheimienne structurent ainsi le travail comme forme sociale.
Cet ouvrage reprend en détail plusieurs parties du programme de Terminale. Il constitue sans conteste une référence pour illustrer nos cours avec des recherches récentes et comparatives, mais aussi pour échapper à la simplification.
Le sommaire de l'ouvrage
INTRODUCTION
Le travail, rapport social
- Travail ?
- Les trois temps de la valse capitaliste
Le travail, institution
- Une grammaire hégélienne
- Une sémantique durkheimienne
I. DI-VISION
01. FRONTIERES
Le travail en question
- Aux sources du travail
- Le travail et ses doubles
- Les critères du droit
Emploi et chômage : classer, compter, mesurer
- Politiques du tri
- Les mesures de l'emploi et du chômage aujourd'hui
- Des frontières incertaines
Coder les professions
- Comment penser les divisions de la société industrielle ?
- L'architecture du système des professions et catégories socio-professionnelles
- Les enjeux du codage social
02. LES MOTS DE LA DIVISION
Valeur et solidarité
- Les vertus économiques du travail et de la division du travail
- Division du travail et solidarité sociale
Sombres guetteurs
- Les formes de division du travail selon K. Marx
- La voie proudhonienne
03. LE SENS DES DIVISIONS
L'effet âge
- Les âges de l'emploi
- Age, organisation et relations de travail
Le genre du travail
- La division sexuée du travail : principes et implications
- La répartition du travail domestique
04. DES QUALIFICATIONS AUX COMPETENCES
Définir la qualification
- Un débat fondateur
- La qualification comme rapport social
Progrès technique et valeur du travail
- A, B, C : le temps de l'optimisme technologique
- L'exception Naville
- La technique, ruse de la raison ou support à l'imagination organisationnelle ?
Négociation des classifications et ordre salarial
- Les fondements socio-historiques de la hiérarchie salariale
- De Parodi aux critères classants
La compétence : enjeux, implications, pratiques
- Les conditions d'une rupture
- Une révolution managériale ?
- Ouvertures, pratiques, interrogations
05. CE QUE TRAVAIL VAUT
Evaluation du travail et politiques salariales d'entreprise
- Salaire à la tâche, salaire au rendement, salaire au temps
- L'évaluation des postes de travail
- L'évolution des politiques salariales
Salaire et rapports sociaux
- Salaire au rendement et contrôle de la production
- Salaire, genre et âge
II. INDIVIDUATION
06. LE TAYLORISME ET SES SUCCEDANES
Le trauma Taylor
- Le corps de la doctrine
- Relais et diffusions
- Taylorisme et automation
La galaxie post-tayloriste
- Une révolution japonaise ?
- Les pièces du puzzle toyotiste
- Une rupture partielle
- Une pluralité de modèles productifs
- Six façons de produire des automobiles
- Un paysage en miettes
07. LA TENSION INDIVIDU-ORGANISATION
Le berceau américain
- Le moment Hawthorne
- Portées, limites
- Les héritiers d'E. Mayo
Culture d'entreprise et mobilisation des subjectivités
- Entreprise, culture et éthique
- Les coûts subjectifs du travail
08. LE TRAVAIL ET LE SOI
Déchirements
- Tristesse ouvrière, chosification des hommes
- Aliénations
- La matrice marxienne
- La perte de soi dans le travail
Action et autonomie dans le travail
- Conscience ouvrière et sociologie de l'action
- Gestions clandestines
- Sape, résistance et appropriations
- Le sens des transgressions
La vague identitaire
- L'identité au travail
- Identité et socialisation professionnelle
- Mobilité sociale, transformations structurelles et troubles identitaires
09. A L'EPREUVE DES SERVICES
Travail et organisation du travail dans les activités de service
- Qu'est-ce qu'un service ?
- Un travail spécifique ?
- Une production conjointe ?
Trois formes de rationalisation
- L'empreinte industrielle
- La logique professionnelle
- Les services solidaires
Un drame social
- La touche interactionniste
- Impératifs et contradictions du travail de professionnel
- Tenir la bonne distance
- Faire preuve de compétences
- Langage, travail et interaction
Grandeurs et servitudes de la relation de service
- Au nom du client : les effets d'une « modernisation » du travail
- Epuisement moral et stress relationnel
- Injonctions contradictoires et perte de sens
III. INTEGRATION
10. ATTACHEMENTS ET DESAFFILIATIONS
La genèse de la société salariale
- Régulations économiques et cultures de classe
- La protection sociale à la française
Déstabilisation du salariat
- Des ouvriers sans classe
- Employé(e)s sous pression
- Banalisation du statut « cadre »
- Insécurité professionnelle et crise du social
11. ENCASTREMENTS
Le travail et la nation
- La fabrication du travail en Angleterre et en Allemagne
- Modèles culturels et logiques nationales
- Interrogations
Rapport salarial et effet sociétal
- Une recherche fondatrice
- Prolongements et inflexions
- Les cultures de métier
- Le geste
- La langue
12. RATIONALISATIONS ORGANISATIONNELLES
Critique de la bureaucratie
- Le parangon bureaucratique
- La bureaucratie en action
Organisation et contingence
Action dirigeante et structures organisationnelles
- Direction administrative et théorie classique des organisations : la griffe fayolienne
- Les stratégies d'entreprise à l'ère de la production de masse
- Métamorphoses du capitalisme contemporain, nouveaux visages de l'entreprise
Les mondes de l'organisation
- Structures et modes de coordination organisationnelles
- Des mondes sociaux de l'entreprise à la multiplicité des logiques d'action
13. L'ORGANISATION EN ACTION
Rationalité, pouvoir et action organisée
- Une rationalité limitée
- Pouvoir et relais
Négociation et intégration
- Organisation du travail et ordre négocié
- Rationalité faible, anarchies organisées et feuilletages organisationnels
Mobilisation du travail et coopération organisationnelle
- La force des réseaux
- Le contrat et la confiance
IV. REGULATION
14. ACTEURS ET REGLES DES RELATIONS PROFESSIONNELLES
Visages du syndicalisme
- Trois modèles de mouvement syndical
- Les critères de la légitimité syndicale
- La France, lanterne rouge
Les organisations patronales
- L'invention du syndicalisme patronal
- Eléments de comparaisons
Une fausse symétrie
- Les registres de l'action étatique
- Juge et partie
- L'Etat et les relations de travail
15. LES FORMES DE L'ACTION COLLECTIVE
Les conflits du travail en perspective
- La grève à la française
- Les transformations des conflits aujourd'hui
Négociation et régulation
- Les formes de la négociation
- De la négociation à la régulation sociale
Les relations professionnelles à l'heure de la mondialisation
- Décentralisation, polarisation et variations sociétales
- La construction de l'Europe sociale
16. DES PROFESSIONS AUX MARCHES DU TRAVAIL FERMES
Professions et professionnalisation : l'option fonctionnaliste
- La tentation idéal-typique
- Points faibles et avatars
- Contrepoints interactionnistes
Carrière et socialisation professionnelle
- Interactions, différenciations internes et division du travail
- La quête de l'autonomie
La dynamique des marchés du travail fermés
- La piste wébérienne
- Clôture et régulation
17. L'EMPLOI EN JEU
L'emploi comme fait social
- Faits et chiffres
- Du problème social au questionnement sociologique
Marché du travail, trajectoires individuelles et relations sociales
- Un héritage institutionnaliste : les théories de la segmentation
- Critiques et inflexions sociologiques
- Emploi et réseaux sociaux
- Les politiques de l'emploi : invention et déploiement
L'Etat et l'emploi
- Marché du travail et action publique
- Stratégie européenne pour l'emploi et méthode ouverte de coordination
- De la modernisation du service public à la flexicurité de l'emploi
CONCLUSION
Travail et travailleurs ne sont plus les mêmes
Conjectures finales
Chapitre I : Di-visions
La première partie offre une réflexion sur les implications des di-visions (les « manières de bâtir et de voir le monde social au travers de filtres cognitifs ») sur les divisions, c'est-à-dire les hiérarchisations et ordonnancements qui structurent le monde du travail. En retour, les divisions pèsent sur les di-visions, en les confortant ou en les invalidant L'auteur concentre en somme son analyse sur la dynamique qui organise les pratiques, les hiérarchies, les inégalités et structure les identités. Cette dynamique étant au cœur des constructions affectant les catégories de l'entendement (les grandes notions que sont le travail, l'emploi, le chômage, les professions explorées dès le début du premier chapitre) et les formes de séparations (dans la répartition des places, dans la hiérarchie des mérites reconnus...).
M. Lallement analyse pour commencer une contradiction majeure des sociétés industrielles : la division du travail est source de croissance économique et de cohésion sociale mais elle est aussi porteuse d'inégalités. L'auteur passe alors en revue les principales réflexions des sociologues sur cette segmentation rappelant ainsi que dans Le 18 Brumaire de L.N. Bonaparte (1852), K.Marx fait l'éloge de la division du travail qui augmente la productivité et élargit les besoins humains, distinguant en fait deux types de divisions du travail : la division sociale et la division manufacturière. La première, au fondement de la production marchande, prend la forme de divers clivages (hommes/femmes ; ville/campagne ; manuel/intellectuel...) et s'accompagne d'une intensification des relations sociales, d'un développement des transports et d'une circulation accrue de la monnaie. Elle est distincte par nature de la division manufacturière conditionnée par l'existence d'une concentration des moyens de production et engendrant un émiettement systématique des tâches.
Mais la division du travail s'étend aussi à l'âge et au genre induisant ainsi des découpages de la population active qui valident l'attribution de tâches et de statuts très variables selon les groupes. On ne peut alors donner un sens à la répartition des rôles et aux hiérarchies professionnelles (les divisions) qu'en analysant les représentations (di-visions) du masculin et de féminin, du jeune et du vieux... Ainsi, M. Guilbert [1] dans une recherche pionnière consacrée aux femmes dans l'industrie des métaux observe que la nature des tâches confiées aux femmes suppose un moindre effort physique, moins de déplacements dans l'espace et de responsabilités que les hommes mais induisent une plus forte répétitivité et un effort de rapidité. L'auteure en déduit que dans l'univers industriel, les représentations qui modèlent les principes d'adaptations et l'efficacité des ouvrières sont inséparables de celles qui gouvernent le partage des tâches domestiques (le travail féminin tant à la maison qu'à l'usine met en jeu les bras, les avant-bras et les mains avec des gestes de faible amplitude). En définitive, l'effort physique est valorisé pour qualifier un emploi mais pas la rapidité. Le principe de la division sexuée du travail valorise certaines façons d'être ou de faire plus que d'autres.
Michel Lallement poursuit ensuite sa réflexion sur les critères permettant de fixer la valeur sociale d'un travailleur ou d'une fonction donnée en abordant la question de la qualification. Il reprend le débat sur la définition de la qualification entre d'une part G.Friedmann et J.-D. Reynaud et d'autre part P. Naville. Les premiers considèrent ainsi que dans le système industriel, « la qualification n'appartient plus à l'homme, elle appartient au poste » [2] Par contre, pour Naville [3], la hiérarchie des qualifications doit être resituée dans la structure sociale dans laquelle elle se forme. La qualification est perçue comme un rapport social reflétant tant le système éducatif (valorisation ou non de l'apprentissage), que les relations professionnelles (cogestion...),...
M. Lallement revient enfin sur un autre débat concernant cette fois le lien spécifique entre la qualification et le progrès technique qui a navigué au cours du temps entre une vision sombre ou plutôt optimiste du rapport entre l'ouvrier et la machine selon que cette dernière induit sa qualification ou déqualification.
La partie la plus stimulante du premier chapitre porte sans conteste sur les déterminants du passage d'une logique de qualification à une logique de compétence. Les efforts de classifications professionnelles sont appréhendés dans leur contexte, soulignant là encore l'influence des di-visions sur les divisions. Les principaux épisodes de l'histoire sociale des classifications sont développés et insistant notamment sur la seconde moitié du XXe siècle. Les grilles Parodi (1945) valident ainsi une classification à l'échelle de l'espace national sur la base des métiers à partir du critère déterminant qu'est le temps d'apprentissage. Les accords de Grenelle marquent en 1968 un autre épisode important. La transformation rapide du système productif ayant fait naître et disparaître de nombreux métiers, de nouveaux principes de codification et de hiérarchisation de la force de travail paraissent nécessaires. Les rapports de force entre les syndicats et l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), aboutissent à l'élaboration deux grilles distinctes, l'une concernant les ouvriers, les administratifs-techniciens et les agents de maîtrise et l'autre rassemblant cadres et ingénieurs. Les acteurs de la négociation adoptent en outre des critères généraux (« critères classants ») devant servir à la mise en équivalence des fonctions et tâches mais ils ne procèdent pas à un classement exhaustif des métiers et des postes. De fait, le travail d'appréciation des qualifications individuelles revient à l'entreprise. Dans le contexte des années 70, où leur pouvoir est fort, ce nouveau système semble permettre aux organisations syndicales de faire localement contrepoids pour négocier les meilleurs compromis. Pour autant, l'affaiblissement des syndicats affecte par la suite l'efficacité de cet instrument de gestion des qualifications pour les salariés en amplifiant la flexibilité du travail.
Le débat sur les qualifications rebondit à la fin des années 1980. Les travaux de P. Zarifian [4] sur des PME du secteur de l'ameublement montrent très tôt que les directions d'entreprise ne souhaitent pas limiter leur évaluation de la main-d'œuvre à des dimensions corporelles (vitesse d'exécution, habileté...) mais souhaitent l'étendre à d'autres formes d'intelligence tout aussi déterminantes comme la capacité d'anticipation, le contact...Les procédures d'évaluation des qualifications paraissent donc dépassées et ce d'autant plus que la complexification de la production modifie la définition des situations de travail.
C'est en définitive l'accord Cap 2000 ratifié en 1990 par la direction d'Usinor-Sacilor et la plupart des organisations de salariés qui amorcera la révolution de la compétence déconnectant l'emploi du poste de travail. L'accord Cap 2000 cherche à « promouvoir une politique de qualification qui reconnaisse les compétences individuelles [grâce à un] dispositif permettant à chaque salarié de se positionner à tout moment de sa carrière individuelle ».. Il s'agit donc de demander au salarié de prendre en main sa propre carrière, de favoriser son autonomie et de mettre en place une organisation du travail mobilisant sa polyvalence. La formation qualifiante doit ainsi constituer une dimension fondamentale de cette nouvelle donne, le développement de la compétence individuelle du salarié servant en effet de moteur de la compétitivité du groupe.
Le MEDEF institue dès les journées internationales de Deauville en 1998 ce nouveau modèle au cœur de ce qui sera nommé la « révolution managériale », liant ainsi clairement logique de compétence et compétition économique. Trois implications à cela : tout d'abord, les compétences sont définies par le triptyque « savoir, savoir-faire, savoir-être ». Ensuite le salarié doit donner priorité à la qualité, ce qui modifie sa responsabilité dans l'acte de production (accepter l'obligation de résultat). Enfin, la logique de compétence lie performance et employabilité puisqu'en échange de l'adaptation du salarié aux exigences de la production, l'employeur s'engage à assurer sa mobilité professionnelle. Les inquiétudes portent donc aujourd'hui selon l'auteur sur la faiblesse des syndicats, limités en tant que force sociale collective capable de peser sur les salaires et les carrières.
La di-vision du monde qui prévalait dans le modèle de la qualification, reflétant les groupes professionnels en présence dans la négociation, laisse place à un modèle de la compétence plaçant au centre l'entreprise et le salarié désormais entrepreneur de sa propre carrière. Les politiques salariales reflètent désormais cet état des termes de l'échange entre employeurs et salariés. Les pratiques d'individualisation du salaire se développent depuis les années 90 notamment sous la forme d'appoints au salaire de base (bonus notamment). En outre, les différences de salaires imputables au diplôme se sont réduites entre 1970 et 1993, passant de 61% à 41% pour les hommes et de 56,1% à 35,6% chez les femmes, ce qui implique que l'expérience devient la variable discriminante. C. Baudelot et R. Establet [5] rappellent ainsi que les écarts de salaires liés à l'âge augmentent puisque les jeunes, principales victimes de la précarité, n'ont pu accumuler un capital d'expérience aussi important que leurs aînés.
Chapitre II : Individuation
La sociologie du travail s'est largement imprégnée ces dernières années des analyses portant sur les paradoxes du mouvement d'émancipation des individus. Les recherches d'A.Erhenberg [6] soulignent ainsi que le mouvement d'autonomisation des individus leur attribuant en particulier depuis les années 1960 la responsabilité de leur destin, engendre une «insécurité personnelle de masse» de laquelle découlent un certain nombre de pathologies. De même, l'approche d'A. Giddens ou d'U. Beck [7] par la « modernisation réflexive » apporte des éléments fondamentaux à la réflexion sur les enjeux de l'individuation sur le travail. La réflexivité désigne en effet dans cette approche la capacité des individus et des institutions à intégrer des informations de natures variées (dont les savoirs savants) dans la conduite de leurs pratiques quotidiennes. Dans ce contexte, toute posture réflexive induit une prise de distance critique qui limite la portée des interprétations traditionnelles du monde et laisse l'individu seul face à son destin. A lui alors d'assumer les conséquences de ses actes (ratés scolaires, divorce, souffrance au travail...). Derrière le terme d'individuation, U. Beck range un certain nombre de faits concernant le travail : ébranlement de la conscience collective et épuisement des cultures de classe, individualisation des trajectoires et brouillage des catégories structurant l'emploi, fragilisation aussi de la famille et émergence d'une culture de la négociation en son sein...
Ainsi selon M. Lallement, l'individuation implique deux processus différents : l'émancipation qui se traduit par un questionnement sur les modes de construction de soi dans et par le travail d'une part et la socialisation qui interroge la diversité et l'évolution des tensions entre l'individu et ses mondes sociaux dont celui de l'entreprise d'autre part.
L'auteur retrace à partir de là l'histoire de l'organisation du travail en insistant sur l'hybridation des modèles productifs et en nuançant la succession temporelle des modèles (passage du taylorisme au toyotisme). Il insiste sur la pluralité des modes d'organisation de la production des biens et services en s'appuyant sur certaines études dont celle de R. Boyer et M. Freyssenet [8] recensant six modèles productifs : taylorien, woollardien, fordien, sloanien, toyotien et hondien. Ces mêmes modèles peuvent coexister dans un même pays. Cette modélisation fournit un descriptif nuancé des multiples manières dont l'organisation du travail a pu être pensée et pratiquée au cours du temps pour répondre aux stratégies diversifiées des entreprises. Le modèle Toyota a ainsi influencé le processus de modernisation de nombreuses entreprises mais prend des formes variées selon les pays ou même d'une entreprise à l'autre induisant aussi une diversité dans les transformations du travail à la chaîne. Pour autant, les exigences post-tayloriennes ne se limitent pas à l'industrie. L'auteur va plus loin en montrant qu'au nom de la flexibilité de la compétitivité, de la qualité ou encore du client, les responsabilités sont de plus en plus reportées sur les individus mis en position d'arbitrer entre diverses logiques souvent contradictoires (respect des délais et souci du travail bien fait). M. Lallement analyse alors la tension individu-organisation pour souligner notamment les rouages de l'injonction paradoxale qui sous-tendent la « culture d'entreprise ». La doctrine d'EDF, analysée par E. Enriquez [9], demande aux salariés d'améliorer la démocratie dans l'entreprise (ce qui indique une tolérance pour le conflit), d'être compétitifs (ce qui suppose un esprit de communauté), de participer (ce qui implique d'accepter les orientations de la direction) et innover (ce qui encourage la prise de risques en s'écartant du modèle de comportement défini par l'entreprise). L'injonction paradoxale semble constituer un moyen efficace pour forcer l'adhésion des salariés et mobiliser les forces vives. L'auteur montre les mécanismes de la rhétorique de l'excellence plaçant le plaisir au fondement de la motivation au travail et permettant à l'entreprise de se saisir du moi idéal du sujet pour lui substituer un idéal d'organisation. Mais l'intériorisation des objectifs et des règles de l'entreprise peuvent se traduire par un surinvestissement dans le travail et par une tension psychologique soulignant « combien peut-être désastreuse sur le plan psychologique l'ingestion à dose forcée des mythes de la mobilisation permanente, de la réactivité sans faille, de la performance à tout prix...tant vantés au début des années 1980 par des thuriféraires de l'excellence (...).» (p.229-230)
L'analyse débouche sans surprise sur un questionnement sur le rapport entre « le travail et le soi » soulignant les étapes successives de la réflexion en sociologie du travail, de son souci de dévoiler l'aliénation des ouvriers dans les années 60 et 70 à l'émergence plus récente d'une analyse en termes d'identité qui s'efforce de propose une lecture pluridimensionnelle des modes de construction de soi dans le travail. Le développement récent d'une sociologie plus tournée vers l'analyse du secteur des services contribue par ailleurs à enrichir ce concept en particulier dans les approches stimulantes de la compétence relationnelle souvent requise des actifs.
Chapitre III : Intégration
M. Lallement explore dans cette partie l'évolution contemporaine des formes d'attachement et de désaffiliation dans le travail. L'auteur reprend la définition que donne R. Castel de l'intégration conçue comme « une formation sociale (...) de l'interconnexion de positions plus ou moins assurées. Sont « intégrés » les individus et les groupes inscrits dans les réseaux producteurs de la richesse et de la reconnaissance sociale. Seraient « exclus » ceux qui ne participeraient en aucune manière à ces échanges réglés. Mais entre ces deux types de situations existe une gamme de positions intermédiaires plus ou moins stables » [10]. L'analyse, qui s'inscrit là encore dans la perspective durkheimienne observe les multiples processus (culturels, politiques, organisationnels...) par lesquels l'intégration par le travail s'opère. L'auteur reprend ainsi les principales étapes de la constitution d'une société salariale et reviens sur la « nouvelle question sociale » conçue comme une remise en cause radicale de la condition salariée. La constitution d'une population de travailleurs précaires ne suffit pas à expliquer la nouvelle question sociale, celle-ci reflèterait pour l'auteur l'ambivalence plus profonde de l'Etat social qui a favorisé l'avènement d'une société salariale induisant ainsi un relâchement des liens de solidarité traditionnels, stimulant l'individualisme et accroissant la dépendance de tous à l'égard du système de protection sociale. La solidarité devenue institution est donc profondément affectée par la progression du chômage et des emplois atypiques.
Pour autant le travail continue de générer du lien et M. Lallement l'analyse sous le prisme de la notion d'encadrement à savoir de l'influence réciproque des pratiques de gestion du travail et de l'environnement (culturel, institutionnel, politique) dans lequel elles s'exercent. Ce chapitre est l'occasion pour l'auteur de présenter une réflexion stimulante sur l'analyse culturaliste et d'illustrer l'importance du contexte institutionnel dans le mode de gestion du rapport salarial l'analyse sociétale à travers des études comparatives extrêmement stimulantes [voir l'entretien réalisé par SES-ENS auprès de M. Lallement] [11]. L'influence d'un environnement organisationnel multiple et évolutif sur les modes d'intégration des travailleurs au sein des univers productifs permet à l'auteur de souligner, dans le chapitre XII consacré à la sociologie des organisations, qu'en dépit de la diversité des structures de l'entreprise contemporaine, « les organisations demeurent des habitacles de premier choix au sein desquels le travail fait plus que jamais litière au lien social. » (p.399)
Chapitre IV : Régulation
La dernière partie de l'ouvrage s'interroge sur la régulation abordée à partir de la théorie durkheimienne de la socialisation et définie comme le « processus, qui par maniement de la règle, permet de clore et d'ordonner l'espace des passions sociales ». La sociologie de travail a rapidement engagé une réflexion sur la règle puisque l'expérience du travail induit que les individus se conforment à un certain nombre de règles techniques, sociales et juridiques sans lesquelles l'activité et la coordination entre acteurs seraient impossibles. Pour autant si la règle générale et abstraite sert de référence pour déterminer comment les choses doivent être, rien n'assure qu'elle soit respectée. En outre, comme le soulignent les approches interactionnistes américaines ou la théorie de la régulation sociale de J-D.Reynaud, dans une organisation, les règles ne font pas nécessairement système. Elles peuvent même s'accumuler en se contredisant. De fait la régulation s'apparente plus à un « travail de bricolage permanent » plutôt qu'à l'édification d'ensemble normatifs cohérents.
L'auteur se penche alors en toute logique sur la régulation par les organisations professionnelles et retrace l'analyse sociologique de l'histoire du syndicalisme salarié et patronal mais aussi de l'intervention de l'Etat dans le jeu social. Michel Lallement présente alors, à l'appuie de l'étude de C. Morel [12], les traits spécifiques aux relations de travail françaises. Une première caractéristique est l'existence d'irruptions collectives récurrentes pour répondre aux problèmes que les relations professionnelles ne parviennent pas à résoudre. La grève froide est la seconde caractéristique, c'est-à-dire un conflit permanent à mi-chemin entre des arrêts de travail durs et radicaux et des négociations pacifiques. Ce type de conflictualité propre à la France s'expliquerait par le fait que cette stratégie est plus avantageuse que celle de la négociation, option qui impose de communiquer et de savoir faire des concessions. Or, le syndicalisme français est faible, divisé et peu équipé sur le plan de l'expertise. Il n'apparaît donc pas nécessairement comme un partenaire crédible pour la négociation : une organisation peut difficilement promettre la paix sociale lorsque les actions et réaction des autres organisations ou des non-syndiqués sont incertaines. Dans ce contexte, il est stratégique de saper les règles du jeu de la négociation pour amplifier par des actions conflictuelles de nature multiple le poids des organisations syndicales aux yeux des directions.
L'analyse débouche sur des critères structurant une classification des modèles de négociation collective selon un clivage Amérique du Nord / Europe Occidentale selon que les relations professionnelles sont décentralisées (pour les premiers) ou décentralisés (pour les seconds). Mais c'es en définitive les modes de régulations sont extrêmement variables d'un pays européen à l'autre puisque le modèle britannique reste centré sur l'entreprise, le modèle allemand se réfère à la branche professionnelle et les pays latins attribuent à l'Etat un rôle majeur. La variété des modes de régulation s'observe même à l'intérieur d'un même pays. J.Saglio [13] recense ainsi en France cinq types idéaux de négociations de branche selon le degré de régulation, l'identité du métier ou le niveau d'intervention de l'Etat. En somme, quel que soit le niveau d'observation privilégié, les relations de travail doivent être appréhendées comme « des processus permanents de production, de mobilisation et destruction de règles », stabilisant sur le cout ou moyen terme les interactions entre les acteurs. La théorie de la régulation sociale souligne de fait la multiplicité des régulations partielles. J.-D. Reynaud dégage ainsi l'existence d'une « régulation de contrôle » à destination des exécutants, imposant des consignes de l'extérieur pour organiser le contenu du travail, les modalités de coopération et l'évaluation des résultats. Mais il souligne aussi la capacité du groupe à élaborer des règles qui lui sont propres (la régulation autonome) qui se superpose à la régulation de contrôle sans se confondre avec. La régulation conjointe qui résulte du compromis entre les acteurs en présence établit un ensemble de règles cohérentes et acceptables pour tous, constituant une solution provisoire au conflit.
Le contexte de la mondialisation affecte indéniablement les relations professionnelles mais pas nécessairement dans le sens d'une dérégulation débridée. M.Lallement souligne ainsi que la construction européenne a incité les Etats et leurs représentants à engager un important travail de régulation. Par ailleurs, l'action des entreprises multinationales reste étroitement dépendante des règles de droits des espaces nationaux. Enfin, à l'exception de quelques cas, les fusions et acquisitions d'entreprises concernent surtout des entreprises de pays de traditions culturelles comparables.
L'ouvrage se termine par une réflexion sur la notion de profession et les mécanismes de la professionnalisation ce qui est l'occasion pour l'auteur de confronter analyses fonctionnaliste et interactionniste et d'évoquer l'analyse weberienne des marchés du travail fermés. La sociologie des professions est riche et variée et contraste en cela avec la sociologie de l'emploi qui émerge tardivement et a longtemps peiné à occuper un espace pourtant laissé vacant par les économistes. Elle apporte pourtant des éléments pertinents pour critiquer certaines limites des théories économiques de la segmentation du marché du travail et contribue à rendre compte des mondes de la précarité dans leur diversité.
Conclusion
M. Lallement conclut au terme de ce dense ouvrage, non pas à une crise du travail mais plutôt à ce qu'il appelle « une nouvelle rationalisation institutionnelle du travail ». Les multiples apports de la recherche contemporaine en sociologie donnent plus que jamais au travail un statut d'institution. L'auteur en voit les symptômes dans les di-visions nouvelles du monde qui se substituent aux anciennes, dans les modes de construction de l'individu (individuation), dans les nouveaux enjeux de l'intégration par le travail ou encore dans les transformations des modes de régulation dominants.
Il pose ainsi un certain nombre de conjectures. D'abord, les institutions ne disparaitront pas à mesure que l'individuation gagne du terrain puisque les institutions ébranlés dans nos sociétés se recomposent ou laissent place à d'autres. L'entreprise figure ainsi selon lui en bonne place pour contribuer à l'institution du social.
Autre conjecture : les institutions sont l'objet de bricolages permanents, de tensions nouvelles qui induisent des recompositions aux dimensions multiples et souvent contradictoires. Enfin, la solidarité contractuelle qui régit de plus en plus nos modèles de société met en avant le mécanisme de la procédure comme objet d'institution du social et supplante les solidarités à fort ancrage statutaire. Dans ce contexte, les parcours des individus dans l'emploi sont plus incertains et ne forment plus des carrières structurées selon un continuum stable de positions sociales. La notion de destin social en est bouleversée et l'individu doit assumer seul la responsabilité de son parcours. A cet égard, la modernité réflexive aide à penser à la fois la continuité et la rupture, soulignant la multiplicité des tensions qui affectent le nouveau régime institutionnel (rupture) et le maintien d'une volonté de contrôle raisonnable de notre destin collectif (continuité).
L'ouvrage de Michel Lallement est une somme pour les enseignants de SES qui retrace en détail plusieurs parties du programme de terminale. Les illustrations sont nombreuses et variées et les recherches présentées sont souvent récentes.
Stephanie Fraisse-D'Olimpio pour SES-ENS
Retour au dossier La sociologie du travail autour de Michel Lallement.
Notes
[1] M. Guilbert, Les fonctions des femmes dans l'industrie, Paris-La Haye, Mouton, 1966.
[2] G. Friedmann et J.-D. Reynaud, « Sociologie des techniques de production et du travail » in G. Gurvich (dir.), Traité de sociologie, vol.1, Paris, PUF, 1958, p.451.
[3] P. Naville, Essai sur la qualification du travail, Paris, Marcel Rivière, 1958.
[4] P. Zarifian, « L'émergence du modèle de la compétence : un essai d'analyse » in F. Stankiewicz (dir.), Les stratégies des entreprises face aux ressources humaines, Paris, Economica, 1988, p.77-82
[5] C. Baudelot, R. Establet, Avoir Trente ans en 1968 et en 1998, Paris, Seuil, 2000.
[6] A. Ehrenberg, La fatigue d'être soi. Paris, O.Jacob,1998.
[7] A. Giddens, Modernity and Self Identity, Cambridge, Polity Press, 1991.
U.Beck, La société du risque, Paris, Aubier, 2001. Edition originale : 1986.
[8] R. Boyer et M. Freyssenet, Les modèles productifs, Paris, La Découverte, 2000.
[9] E. Enriquez, « Les contradictions de l'éthique à EDF », in H.Y. Meynaud (dir.), Les sciences sociales et l'entreprise. Cinquante ans de recherche à EDF, Paris, PUF, 2000.
[10] R. Castel, « Les marginaux dans l'histoire », in S. Paugam (dir.), L'exclusion, l'état des savoirs, Paris, La Découverte, 1996, p.32
[11] M. Maurice, F. Sellier, J.-J. Silvestre, Politique d'éducation et organisation industrielle en France et en Allemagne, Paris, PUF,1982.
M. Bauer, B. Bertin-Mourot, « Le recrutement des élites économiques en France et en Allemagne », in E. Suleiman, H. Mendras (dir.), Le recrutement des élites en Europe, Paris, La Découverte, 1995, p.91-112.
[12] C. Morel, La grève froide, Paris, Editions d'Organisation, 1981.
[13] J. Saglio, « La régulation de branche et l'unité du système français de relations professionnelles : le cas des négociations de classifications », Droit social, 1, janvier 1987, p.20-33.